Malgré les pluies de la semaine du 15 au 20 août, toujours inférieures aux normales de saison, la sécheresse reste très marquée en Côte-d’Or, comme dans l’ensemble du territoire métropolitain. Aux faibles précipitations depuis l’hiver dernier, se sont ajoutées des températures très élevées lors de trois épisodes caniculaires successifs.

Dès le 10 juin, les mesures de restriction d’usage de l’eau avaient été mises en place. Elles ont déjà été renforcées à trois reprises. Si les pluies de la semaine dernière marquent une temporisation dans la baisse des débits des rivières, elles ne remettent pas en cause la situation généralisée de crise. La situation s’est ainsi dégradée depuis le 4 août, où un tiers du département était déjà en crise. Le préfet a donc réuni, le 18 août, le comité départemental Ressources en eau, avec les représentants de l’ensemble des usagers et des principales collectivités.
Le suivi hydrologique, réalisé en continu par les services de l’État, a mis en évidence une nouvelle aggravation de la situation en Côte-d’Or qui se traduit par le franchissement du seuil de crise dans 9 zones d’alerte.
A Dijon, la sécheresse est extrême. Alors que la pluviométrie moyenne pour un mois d’août y est de 60 millimètres par mètre carré (soit 60 litres d’eau), il n’est tombé que 13 millimètres sur la ville depuis le début du mois. Pis encore, en juillet dernier, la station de Dijon n’avait enregistré que 6 mm de pluie à comparer à une normale à 65 millimètres.
Communiqué de la préfecture de Côte-d’Or, daté du 19 août : « Sécheresse en Côte-d’Or : des territoires en crise. Des nouvelles mesures de restriction applicables à compter du lundi 22 août 2022 ».
La situation est désormais la suivante :
- Seuil d’alerte : Dheune et Ouche amont,
- seuil d’alerte renforcée : Tille amont, Bèze-Albane et Armançon-Brenne,
- seuil de crise : Saône moyenne, Vingeanne, Tille aval-Norges, Cents Fonts-Biètre-Vouge, Bouzaize-Lauve-Rhoin-Meuzin, Ouche aval, Serein-Romanée, Chatillonnais et Arroux-Lacanche.
Ainsi, au 16 août, les deux tiers du territoire départemental ont atteint le niveau le plus élevé d’alerte, celui de « crise« . Le niveau des rivières est très bas avec de nombreux assecs constatés (voir carte et annexe 1, ci-dessous).
Dépérissements (bis)
Diaporama 1 / Combe à la Serpent, le 21 août 2022 / photos : © Ishta
« L’affaiblissement des peuplements forestiers »
En forêt, le stress hydrique violent est flagrant pour de nombreux arbres, comme j’ai pu le constater hier, le dimanche 21 août, sur l’ubac (coteau tourné vers le Nord) de la Combe à la Serpent, versant forestier habituellement frais et humide, même en plein été (voir le diaporama, ci-dessus, et le reportage photo). Les couleurs de la végétations y étaient presque les mêmes que celles photographiées le 21… novembre de l’année précédente (voir le diaporama 2, ci-dessous), et nettement plus « brûlées » qu’à la fin de septembre 2021 (voir le diaporama 3, encore ci-dessous).
Diaporama 2 / Combe à la Serpent, le 21 novembre 2021 / photos : © Ishta
Diaporama 3 / Combe à la Serpent, le 26 septembre 2021 / photos : © Ishta
Comme le relevait le département de la santé des forêts de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), le 8 août dernier, déjà, « les premiers impacts visuels (flétrissement, rougissement-jaunissement et chutes foliaires parfois encore vertes) commencent à s’observer depuis cette fin juillet notamment chez les feuillus (charme, tilleuls, hêtre, alisiers en particulier) sur les sols aux plus fortes contraintes hydriques ». Avant de préciser : « Il est important de rappeler que cette symptomatologie est un mécanisme de survie des feuillus pour limiter l’évapotranspiration et ne prédit pas du dépérissement des arbres ; en revanche, la croissance en est affectée. Chez les résineux en revanche, un rougissement important du feuillage est très fréquemment gage de mortalité à terme. » Et de prévenir, en termes prudents : « Ce déficit hydrique 2022 s’inscrit dans une répétition d’étés chauds et secs depuis 2015 en région et intervient sur des peuplements forestiers encore fragilisés par celle-ci. Ainsi, nous nous situons dans une configuration toute singulière, vraisemblablement inédite, dont les impacts globaux sur la santé des forêts demeurent par conséquent inconnus quant à leur intensité et à leur étendue… »
Aussi, en élargissant le point de vue sur l’avenir des forêts de Bourgogne-Franche-Comté, il n’est plus pessimiste de craindre une catastrophe générale. Car « la répétition d’années marquées par des épisodes remarquables de sécheresses et canicules depuis 2015 accentue l’affaiblissement des peuplements forestiers » (DRAAF, août 2022, pp. 4 et 5). Plusieurs risques potentiels sont d’ores et déjà identifiés en lien avec la répétition de déficit hydrique et qui pourraient aggraver les dépérissements en cours ou en révéler sur de nouvelles zones au printemps 2023 :
- Les réserves carbonées des arbres seraient affectées (régulation de photosynthèse par déficit hydrique et chute foliaire souvent précoce en 2018, 2019, 2020 et 2022),
- une recrudescence des attaques de parasites de faiblesses (champignons, insectes) qui s’opère classiquement les années suivant la sécheresse et dont les impacts pourraient s’amplifier après plusieurs années d’affaiblissement des peuplements.
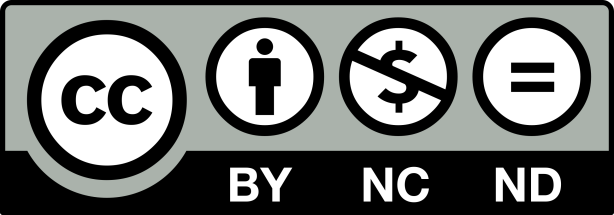
Antoine Peillon
ANNEXE 1
Mesures préfectorales du 22 août 2022

LES RESTRICTIONS DES USAGES DE L’EAU POUR LES TERRITOIRES EN ALERTE (EN JAUNE SUR LA CARTE)
En alerte, l’usage de l’eau est autorisé avec restrictions.
Par exemple, afin de limiter la perte d’eau par évaporation, l’arrosage des potagers est interdit aux heures les plus chaudes soit entre 11h et 18h. Ces horaires s’appliquent également pour l’arrosage des pelouses, massifs fleuris et plantes en pots, sauf si utilisation de goutte à goutte pour les plantes en pots. Ces mesures visent à réduire notre consommation en eau tout en incitant à l’utilisation d’équipements économes en eau. Un autre exemple est le lavage des voitures : s’il est interdit à domicile, il reste possible chez un professionnel qui utiliserait du matériel haute pression ou équipé d’un système de recyclage de l’eau.
LES RESTRICTIONS POUR LES TERRITOIRES EN ALERTE RENFORCÉE (EN ORANGE SUR LA CARTE)
En alerte renforcée, tous les prélèvements ne peuvent plus être simultanément satisfaits.
Cette situation conduit à une limitation progressive des prélèvements et le renforcement substantiel des mesures de restriction des usages si nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise.
A titre d’exemple, l’arrosage des pelouses, des massifs fleuris et des plantes en pot est interdit sauf utilisation du goutte à goutte. S’agissant des jardins potagers, la plage horaire d’interdiction d’arroser est élargie de 9h à 20h.
LES MESURES D’INTERDICTION POUR LE TERRITOIRE EN CRISE (EN ROUGE SUR LA CARTE
Le niveau de crise déclenche des interdictions afin de préserver les usages prioritaires : santé, sécurité civile, eau potable, salubrité, abreuvement des animaux.
Tous les usagers de l’eau sont concernés. L’arrosage des pelouses, massifs fleuris, plantes en pot, espaces verts est interdit. Le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées n’est plus possible sauf impératif sanitaire. Les prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole sont également interdits à l’exception de certaines cultures sensibles.
ANNEXE 2
« La forêt est notre bien commun, précieux et fragile. »
Communiqué commun des groupes « Notre Région par cœur », « Écologistes et solidaires » et « Élus communistes et républicains » (majorité au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté), le 18 août 2022 :
« Jamais notre région n’avait subi de tels incendies de forêts. Tous les grands massifs forestiers sont touchés : Vosges, Morvan, Jura où plus de 1000 hectares ont brulé…
Nous remercions toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés sans relâche : sapeurs-pompiers de Bourgogne-Franche-Comté, renforts aériens venus du sud de la France, agriculteurs et élus locaux.
Ces incendies sont une des conséquences directes du changement climatique : les forêts sèchent, se fragilisent. Les maladies se développent et les rendent de plus en plus sensibles.
Face à cette situation, nous devons tout faire pour réduire drastiquement nos émissions de CO 2 , limiter l’ampleur des bouleversements à venir et préserver nos territoires.
Ces feux inédits révèlent aussi les faiblesses de notre système de lutte contre les incendies. Il faut un réengagement massif de l’État dans une politique de sécurité civile, avec notamment une force d’intervention aérienne mutualisée et coordonnée à l’échelle européenne et le recrutement de plus de pompiers professionnels formés à ce risque. Or, depuis 2017, les moyens ont été fortement réduits, 261 centres de secours locaux ont fermé et le système de Défense des Forêts Contre les Incendies a été affaibli…
La France doit également se donner les moyens d’une politique forestière ambitieuse.
Comme nous l’avions déjà exprimé il y a un an par l’intermédiaire d’un vœu en assemblée plénière, il faut annuler les 500 suppressions de postes prévues à l’ONF et redonner à cet établissement public les moyens de ses missions, notamment la prévention, la surveillance, l’entretien de la forêt et la police de la nature.
La forêt est notre bien commun, précieux et fragile. Nous devons la préserver pour qu’elle assure pleinement toutes ses fonctions : production de bois, production d’oxygène, fixation de carbone, protection des sols, réservoir de biodiversité, participation au cycle de l’eau, accueil du public…
À son niveau, la Région anticipe face à l’accroissement de ce risque en concentrant les fonds européens FEADER destinés à la forêt, sur la création et le renforcement des voiries forestières, car l’accessibilité aux massifs forestiers est un préalable indispensable à la surveillance et à la lutte contre les incendies de forêts.
L’État doit refonder sa politique forestière pour tendre vers des forêts plus résilientes : fin des coupes rases et des plantations monospécifiques au profit des mélanges d’essences et de couvert continu. Il faut permettre à la forêt de s’adapter, à la nature et au temps de faire leur œuvre. Une vigilance particulière devra être portée aux zones brûlées, afin d’en faire des modèles de régénérescence en associant l’ensemble des acteurs locaux. »
ANNEXE 3
Sécheresse, canicule, feux et orages violents :
le cercle vicieux du changement climatique
« Le changement climatique, c’est un emballement », explique le météorologue Gaël Musquet, spécialiste de la prévention, de la prévision et l’anticipation des catastrophes naturelles. « On cumule la sécheresse des derniers mois, les fortes chaleurs et les feux. Cela touche les masses d’eau et les masses boisées. La végétation transpire, crée de la vapeur qui se condense avec le froid et forme des nuages qui vont déclencher des phénomènes électriques, de la foudre et de la pluie. Ce qui est difficile aujourd’hui, avec le changement climatique, c’est de prévoir ces évènements de plus en plus extrêmes et fréquents », analyse le météorologue qui évoque un « cercle vicieux »…
Extrait d’un article très complet de Novethic.
Face à ce « cercle vicieux », sécheresses et incendies dramatiques, les préconisations de France Nature Environnement (FNE), entre autres associations / ONG, sont de bon sens :
- « Sécheresse 2022 : un moment historique qui doit remettre en question notre gestion de l’eau. »
- « Incendies : nos forêts ont besoin d’urgence d’une plus grande diversité. »
Enfin, je me permets de rappeler nos propres analyses et propositions (NUPES), publiées sous le titre « La BIODIVERSITÉ, c’est vital pour l’Humanité ! » en mai dernier, à propos de « la Côte-d’Or, département qui bénéficie d’une nature particulièrement généreuse, diversifiée, encore préservée, mais aussi malheureusement menacée par le changement climatique, la surexploitation de la forêt, la dégradation des ressources (l’eau, en premier lieu), les pratiques d’agriculture intensive et la déraison de certains chasseurs ».
ANNEXE 4
Le climat dijonnais vers 2050
Notre futur climatique, selon les données collectées et présentées par l’AFP auprès de Météo France, avec ce commentaire : « Les données fournies par Météo France offrent des estimations précises de la situation de votre commune dans quelques décennies. Il est alors possible de comparer le climat que vous avez connu hier, entre 1976 et 2005 (il s’agit de la période de référence pour toutes les comparaisons de cet article) à celui que vous vivrez demain, autour de 2050. »
Consulter l’outil interactif « Climat HD » de Météo France (en choisissant la région « Bourgogne » dans l’onglet « Climat futur ». Entre autres avertissements : « La comparaison du cycle annuel d’humidité du sol sur la Bourgogne entre la période de référence climatique 1961-1990 et les horizons temporels proches (2021-2050) ou lointains (2071-2100) sur le XXIe siècle (selon un scénario SRES A2) montre un assèchement important principalement en fin de siècle. En termes d’impact potentiel pour la végétation et les cultures non irriguées, cette évolution se traduit par un allongement moyen de la période de sol sec (SWI inférieur à 0,5) de l’ordre de 1 à 3 mois tandis que la période humide (SWI supérieur à 0,9) se réduit dans les mêmes proportions. »
Plus largement, consulter aussi le sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) : « La multiplication des vagues de chaleur, des sécheresses et des inondations excède déjà les seuils de tolérance des végétaux et des animaux, provoquant la mortalité massive d’arbres, de coraux et d’autres espèces. Du fait qu’ils surviennent simultanément, ces extrêmes météorologiques ont des répercussions en cascade de plus en plus difficiles à gérer. » Ainsi que l’alerte apocalyptique de onze climatologues publiée par le Journal de l’Académie des sciences des États-Unis (PNAS) et rapportée par l’excellent Reporterre, le quotidien de l’écologie (3 août 2022).
A. P.
Mise à jour du 31 août (source : Le Bien public)
« La station de Dijon-Longvic a même battu un record cet été : le nombre de jours consécutifs avec une température supérieure à 25 °C (soit le seuil de chaleur). Jusqu’ici, on avait compté jusqu’à 34 jours consécutifs, en 2003. Désormais, le nouveau record est de 38 jours. « C’est vraiment une donnée énorme », indique Stéphane Nedeljkovic (prévisionniste pour Météonews), qui n’est pas pour autant surpris. Car c’est là que se trouve la différence majeure entre 2003 et 2022. « En 2003, il y avait des variations de températures », avec des creux dans les fortes chaleurs. Sauf que cette année, ce n’est pas le cas. « Nous n’avons pas eu de baisse. Les chaleurs ont été constantes », note le météorologue. »











































